« Un film, presque rien, à peine visible. C’est ça qu’il faut, j’ai rien dans les mains. » M. Duras.
« Il ne reste que l’histoire
Le tout.
Rien que cette rocaille de marbre sous les pas
Cette poussière.
Et le bleu des colonnes noyées » M. Duras (Le Navire Night)
Le texte qui va suivre a déjà fait l’objet, en partie, d’une publication dans l’excellente revue canadienne horschamps. Il s’agit donc aujourd’hui de recycler, repriser, nettoyer une obsession, celle de l’écriture durassienne et de son cinéma, à moins qu’il ne faille plutôt interroger la décantation de l’image cinématographique par la parole d’une femme qui passe (Le Camion). Dans La mort du jeune aviateur anglais de Benoît Jacquot produit par l’INA, sorti en 1996 et récemment édité à la fin de 2009 en DVD aux éditions Montparnasse, une conversation filmée avec Marguerite Duras dans son appartement parisien entraîne le spectateur dans une dérive imaginaire et historique à la fois. Imaginaire car les images sont là dans toute leur propreté, c’est-à-dire sans arrêter la planification rigoureuse d’un plan de cinéma. Dialogue croisé avec des prises de vues à Vauville, petit village de Normandie, lieu de l’accident et de la mort d’un jeune aviateur anglais âgé de vingt ans et orphelin. Duras raconte à Benoît Jacquot le récit de cette mort qui l’a complètement bouleversée. La reprise de l’histoire prend forme dans l’intimité de la relation et sous l’impulsion d’une parole acquise à moitié grâce à la présence de la caméra (avec Caroline Champetier à l’image).

Marguerite Duras
Cette histoire-là, Duras affirme qu’elle ne pourrait pas l’écrire ou bien qu’elle ne le voudrait pas. C’est pourtant suite à ce film qu’elle écrira ce récit publié en 1993 « Le début, le commencement d’une histoire. » La dernière phrase : « (…) Et puis un jour, il n’y aura rien à écrire, rien à lire, il n’y aura plus que l’intraduisible de la vie de ce mort si jeune, jeune à hurler. » La béance douloureuse qui emporte l’écrivain jusqu’au bord des larmes est celle de la mémoire. Paul, son jeune frère mort en Indochine sans funérailles ni cérémonial rejoint comme un météore la mort du jeune aviateur anglais tué en plein ciel par les allemands tandis que la seconde guerre mondiale se terminait. Une image écrite plus tard : « À Vauville, la mémoire du chant de la mendiante me revient. Ce chant très simple. Celui des fous, de tous les fous, partout, ceux de l’indifférence. Celui de la mort facile. Ceux de la mort par la faim, celle des morts des routes, des fossés, à moitié dévorés par les chiens, les tigres, les oiseaux de proie, les rats géants des marais. » Une histoire qui ne peut ni se filmer, ni s’écrire, ni se montrer en totalité, de nature inachevée mais qui pourrait pourtant exprimer la totalité de l’émotion et puis cesser. On retrouve aussi l’idée des haïkus topographiques dans ce film. Une longue séquence dans le jardin de l’église où au milieu de la pelouse il y a un tombeau, une pierre de granit gris sur laquelle est écrite le nom du jeune anglais, W. J Cliffe. En dehors du cimetière communal, la tombe isolée du jeune anglais a été dressée par tous les habitants du village et sans autorisation. Une situation à la fois archaïque et révolutionnaire. Décrire plutôt qu’inventer, insister en lents panoramiques sur ces quelques lieux désertés. L’image tend vers l’évidemment la précision et la netteté. Mettre en lumière le désert et le silence.
Duras a une haute idée de la littérature et celle-là lui semble sans commune mesure avec le cinéma. C’est peut-être ce qui lui fait dire à Jean-Luc Godard, lors d’un entretien réalisé à Paris le 2 décembre 1987, « tu ne tiens pas le coup devant l’écrit ». Cependant avec l’histoire de la mort du jeune aviateur anglais, Duras assume la déficience originelle de ne pouvoir écrire ni filmer d’une certaine façon le récit de cette mort : « je ne peux rien dire. Je ne peux rien écrire » et elle l’écrit. Il faudrait peut-être filmer ça, dit-elle à la chef opératrice : à l’image, un lent panoramique ascendant le long du mur de l’église de Vauville, paroi grise criblée de balles, traces de la guerre, rien d’autre à voir. « Et puis après j’ai vu autre chose. Toujours, après, on voit des choses (…) Les arbres morts sont là, fous, figés dans un désordre fixe, tellement, que le vent ne veut plus d’eux. Ils sont entiers, martyrs, ils sont noirs, du sang noir des arbres tués par le feu.» C’est en racontant face à la caméra, en retournant sur les lieux qu’elle voit avant d’écrire. La parole entre Benoît Jacquot et elle (parole filmée qui tient aussi à l’inscription physique particulière de la voix de Marguerite, une voix abîmée par la maladie) a donc préparé l’écrit puisque suite à ce film elle s’interroge (avec la même équipe et la même production) dans sa maison de Neauphle-le-Château sur la sauvagerie de l’écriture et sa caverne avec Écrire…
l’écran de cinéma peut être transformé en fenêtre noire, devenir un lieu iconoclaste de vacuité et d’attente interminable. Un échange entre le ne pas tout voir jusqu’au ne pas tout entendre. Cet écart et cette lacune le spectateur doit les prendre en charge avec sa propre imagination, être travaillé (par le regard et par l’écoute) par les lieux désertés qu’offrent certaine œuvres. La mort du jeune aviateur anglais de Duras se pose la problématique de la jointure entre le texte (sa transformation par le médium cinématographique) et une image entièrement noire. Image inachevée dans le film de Duras. Interroger les raisons qui conduisent ces trois films à maintenir coûte que coûte une tension portée jusqu’à son plus haut degré entre le lieu noir rectangulaire de l’écran et celui incommensurable de la parole. Lorsque cela suppose la prédominance du verbe contre l’illusion et la reconstitution, le lieu lacunaire et noir devient alors le lieu juste ; plans monochromes blancs ou noirs qui substituent au regard du spectateur la ruine de toute représentation. Quelles sont les exigences qui font naître les images et qui ont le pouvoir d’interroger leur simple, trop simple apparition ?
Filmer est un acte conséquent et s’emparer d’un texte littéraire (ce que fait Duras avec Le Navire Night) à des fins cinématographiques en est un autre. Soustraire plutôt que rajouter dans l’ombre et à l’écart, rejoindre en esprit et non à la lettre la crise de la représentation. Le détournement d’un matériau doit s’interroger sous les auspices à la fois poétiques (inventer de nouvelles formes pour de nouvelles situations) et éthiques (refuser le mensonge de la reconstitution, lui préférer la description rigoureuse et clinique. Décrire plutôt qu’inventer). Phrases sans images et films imperceptibles. Pourquoi ne pas ouvrir, pour finir, sur un ultime renversement : est-ce que le fait de voir (la puissance d’évocation de certains lieux et faits) ne permettrait pas aussi d’enclencher d’autres procédures d’écriture, de cinécriture ?
En somme un écran propre comme un plan noir, incommensurable comme la vie, par delà le vrai et le faux.
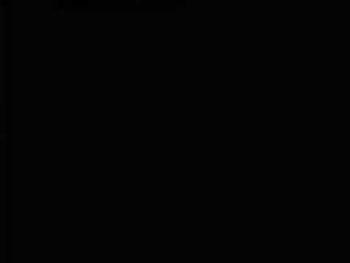
(…) ma vie est un film doublé,mal monté, mal interprété, mal ajusté, une erreur en somme. Un polar sans tueries, sans flics ni victimes, sans sujet, de rien. Il pourrait être un vrai film dans ces conditions et non il est faux. Allez voir ce qu’il faudrait pour qu’il ne le soit pas. Que je sois sur une scène sans rien dire, sans un geste, à me laisser voir, sans penser spécialement à quelque chose. C’est ça.1
Stéphanie Serre
1 Marguerite Duras, La Vie matérielle, Les cheminées d’India Song, éditions Gallimard, Folio, 1994, p. 157.
