Étreintes rêveuses : les nuits oniriques de Hollywood
Cet article propose d’aborder la problématique du nocturne dans les arts visuels contemporains à l’aune de quelques romances hollywoodiennes d’un genre particulier. Situées à la « marge » du canon classique – pour reprendre la terminologie de Jean-Loup Bourget1 –, ces fictions font groupe autour de leur thème amoureux et d’un recours systématique au moment « nocturne », toujours investi d’une portée symbolique. Dans l’ombre de la nuit, en marge du monde diurne et rationnel, la rencontre avec l’Autre évoque ici le franchissement d’un seuil, l’entrée dans un espace-temps ontologique où l’expérience de l’amour, la nuit, ouvre sur la connaissance de soi et l’au-delà de la mort.
Par-delà sa dimension spatio-temporelle immédiate, le nocturne apparaît ainsi comme un motif esthétique qui permettrait, tel le sublime, de faire apparaître, de montrer ce qui par définition ne se montre pas : plénitude du monde intérieur, franchissement de la limite entre vie et mort, entrelacs des âmes unifiées par-delà le corps et le temps. Telles seraient parmi quelques autres les acceptions prises dans ces films par la nuit, et que nous proposons de mettre au jour à travers une approche attentive au récit conjointement à la forme.
La Nuit créatrice
Le Portrait de Jennie (Portrait of Jennie, 1949), de William Dieterle, demeure sans doute l’exemple le plus évident et le plus singulier. Réalisé sous la houlette du producteur maniaque David. O. Selznick, le film retrace les errances d’Eben Adams (interprété par Joseph Cotten), peintre paysagiste en mal d’inspiration dont les déambulations diurnes à Central Park figurent, selon ses propres mots dans le film, « un hiver de l’esprit », saison morne de l’artiste réduit au vide créateur face au « sentiment terrible de la froide indifférence du monde » (fig. 1).




Fig. 1
Systématiquement, William Dieterle accompagne les errances nocturnes du peintre à Central Park de Nuages (1897-1899) de Claude Debussy, composé par le musicien d’après les nocturnes picturaux de James McNeill Whistler (eux-mêmes inspirés des Nocturnes de Chopin) représentant la Tamise londonienne ou le canal de Venise plongés dans un crépuscule embrumé2. Dans Le Portrait de Jennie, l’alliage du thème de Debussy aux déambulations nocturnes du peintre à Central Park évoque la tradition du nocturne américain, en particulier les œuvres des artistes tonalistes et pictorialistes, qui s’étaient attachés à représenter ou à photographier les jardins de Manhattan à l’heure nocturne pour y suggérer, entre autres, l’émergence du transcendant3 (fig. 2).


Fig. 2
De façon notable, en effet, certaines œuvres de cette tradition, comme les toiles de Thomas Wilmer Dewing ou quelque cliché d’Edward Steichen, montrent d’énigmatiques figures féminines au milieu de tels jardins nocturnes (fig. 3). Celles-ci constituent, selon l’analyse d’Hélène Valance dans son livre sur le nocturne américain, « autant d’allégories appuyant la volonté de suggérer une certaine transcendance, le dépassement du simple visuel4 ».



Fig. 3
Or c’est précisément dans ce contexte tonaliste, à Central Park et à l’heure nocturne, qu’intervient dans le film l’énigmatique figure de Jennie, jeune femme morte des années auparavant dans un raz-de-marée et dont les interventions inexplicables auprès du peintre inspirent à ce dernier son grand sujet, Le Portrait de Jennie. Les apparitions soudaines et répétées de ce personnage au milieu de la nuit sont toujours précédées dans la mise en scène de bouleversements formels, aussi bien visuels que sonores, qui suggèrent l’entrée dans un espace-temps alternatif, indépendant du monde perceptible par les sens et relatif à l’imagination ou à l’esprit du peintre. Ce que connote la texture même des plans qui précèdent immédiatement ces apparitions, imitant celle d’un canevas, pour véhiculer l’idée que nous entrons bel et bien dans la vision mentale ou la conception du peintre5.
Ainsi, sur le plan tonal, le nocturne Nuages de Debussy s’enchaîne-t-il chaque fois avec les arabesques orientalisantes du Prélude à l’après-midi d’un faune (1892-1894) du même compositeur, d’après le poème fantaisiste de Mallarmé sur les songes de l’amour. Sur le plan visuel, des intensifications lumineuses dans les jardins nocturnes de Central Park, manifestées sous diverses formes – étrange soleil de nuit, réverbères ou clair de lune –, complètent cette atmosphère tonaliste et onirique (fig. 4).


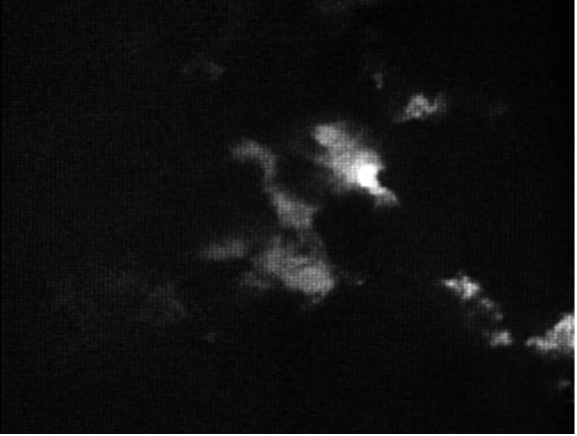

Fig. 4
Cependant que le peintre évoque systématiquement en off son impression d’entrer dans un temps suspendu, mêlant passé et présent – comme si, au cœur de la nuit, l’éternité elle-même s’immisçait par une brèche ouverte dans l’espace temporel. « Suddenly, I had the awareness of something extraordinary », médite-t-il un instant avant sa première rencontre avec Jennie. « The city sounds were muted and far away; they seemed to come from another time, like the distant call of a meadow long ago. » Survient alors la figure éthérée de Jennie, qui semble littéralement apparaître et disparaître dans les émanations lumineuses de la lune ou des réverbères de Central Park (fig. 5).




Fig. 5
D’abord fillette, de plus en plus âgée à chacune de ses apparitions auprès du peintre, elle cherche la solution au phénomène énigmatique qui la rappelle chaque fois de la mort pour couler des moments heureux avec le héros. C’est elle qui, telle la muse des Anciens grecs, lui inspire dans sa mansarde, au fil de quelques nuits d’amour, le chef-d’œuvre à l’origine du titre du film, Le Portrait de Jennie6. Dans la scène où Eben achève le portrait, la jeune femme apparaît dans la lumière vers le fond du champ, tandis que le héros reste plongé dans l’obscurité, œuvrant symboliquement dans l’ombre du modèle qui le guide. Jamais perçue par d’autres personnages que par Eben7, source des moqueries des amis du peintre qui le croient fou, Jennie représente dans la diégèse ce souffle d’amour et de création, forcément invisible, conçu comme une force nocturne – parce que cachée – descendant dans la vie du peintre pour l’arracher à l’« hiver de [son] esprit » et lui insuffler son inspiration.
C’est cette idée qui, à la fin de la scène de tableau, justifie la référence au « Portrait ovale » (« The Oval Portrait », 1842) d’Edgar Poe, quand, un court instant, Jennie s’assoupit mais semble mourir dans d’étranges brumes alors que le peintre apporte la dernière touche à son portrait – manière d’indiquer que le transfert ontologique du modèle à l’œuvre vient effectivement de s’opérer, que la présence fugitive de Jennie s’est pérennisée sur la toile (fig. 6).


Fig. 6
Le thème de la nuit comme espace des révélations amoureuses et créatrices culminera avec les ultimes retrouvailles du couple, dans un improbable cataclysme sur la péninsule du cap Cod, moment fantasque sans comparaison possible à Hollywood et probablement dû à David O. Selznick8. L’esthétique de la scène, où Jennie vêtue de blanc aborde dans la nuit la péninsule rocheuse sur une embarcation, combinée à son thème mortuaire, rappelle cette fois-ci la nuit romantique de L’Île des morts (1880-1886) d’Arnold Böcklin9, tandis qu’une citation du Livre des rois par un marin se charge d’établir le lien avec la « nuit » biblique et son message rédempteur (fig. 7).



Pour corroborer la dimension surnaturelle de ces ultimes retrouvailles, Dieterle et Selznick teintent chromatiquement l’ensemble de la scène, fondant la nuit au vert, couleur dont Vertigo (1958) nous apprendra qu’en un tel contexte nocturne, elle signale la suspension du Temps et la résurgence de la mort. Dans un orgasme cosmique, émergeant littéralement d’une explosion de vagues, telle Aphrodite, Jennie retrouve Eben au pied du phare phallique du cap Cod, pour lui révéler en mourant le secret de la grande énigme qu’elle recherchait, et dont la nuit lui a finalement apporté la révélation : « There is no life, my darling, before loving and being loved, and then there is no death ». Si le cyclone qui les menace représente en effet la spirale du Temps, les mots de Jennie doivent conforter Eben dans le fait que leur amour existe en dehors de sa sphère et échappe à son emprise.
À l’aube, pourtant, repêché seul du cataclysme, allongé dans la lumière mauve du jour qui fait désormais apparaître la rencontre nocturne avec Jennie comme un rêve chimérique, le peintre doute de la réalité de sa vision. Mais l’écharpe du personnage féminin retrouvée sur la plage à son côté – objet talismanique tout droit issu de la littérature fantastique – est là pour lui prouver que la vision était bien réelle, que Jennie et la nuit n’étaient pas un songe. Accrochée au musée d’art de New York dans la dernière scène du film, l’œuvre que la jeune femme lui inspira jadis à l’heure nocturne dans sa mansarde nous est finalement restituée en couleurs dans ce film en noir et blanc, pour attester que le modèle invisible, Jennie, a effectivement été transféré sur la toile et que la présence de cette figure énigmatique, de la nuit, a bel et bien marqué de son sceau la vie du peintre (fig. 8).



La tradition des « fidèles d’amour »
Exemple archétypal qui condense à lui seul tous les motifs, Le Portrait de Jennie éclaire à son tour une série d’autres fictions hollywoodiennes tout aussi « à la marge » du canon classique, dans lesquelles la nuit symbolise toujours cette même rencontre avec l’Autre en un espace ontologiquement incertain, mélange de réalité et de rêve, où l’amour serait roi. Des fictions qui font groupe, précisément, autour de ce même traitement onirique de la nuit et d’une certaine inspiration gothique qu’elles partagent avec Le Portrait de Jennie : mentionnons Peter Ibbetson (1935) d’Henry Hathaway, L’Aventure de Mme Muir (The Ghost and Mrs. Muir, 1947) de Joseph L. Mankiewicz, Pandora (Pandora and the Flying Dutchman, 1951) d’Albert Lewin, Brigadoon (1954) de Vincente Minnelli ou encore Vertigo d’Alfred Hitchcock, parmi les plus beaux exemples.
De telles fictions attestent la persistance à Hollywood de la tradition des « fidèles d’amour », dont l’une des sources les plus anciennes en Occident serait, avec la légende d’Orphée, le mythe d’Amour et Psyché rapporté par Apulée dans L’Âne d’or. Exemplifié dans l’Italie médiévale par Guido Cavalcanti et surtout Dante, le thème trouve une étonnante postérité dans la littérature romantique : de Ligeia (1838) et Eleonora (1841) d’Edgar Poe à Aurélia (1855) de Gérard de Nerval, Spirite (1865) de Théophile Gautier ou encore Véra (1874) de L’Isle-Adam, en passant par Les Hymnes à la nuit (1800) de Novalis et Le Vase d’or (1814) d’E.T.A. Hoffmann – toutes œuvres dans lesquelles la nuit tient une place centrale eu égard à l’amour –, le thème est l’une des obsessions les plus constantes de cette littérature du XIXème siècle (fig. 9).

Il s’allie au motif nocturne notamment à travers Roméo et Juliette (1597) de Shakespeare, version moderne du mythe de Thisbé et Pyrame rapporté par Ovide dans les Métamorphoses, où la nuit constituait déjà le lieu de la réunion mortuaire des deux amants. Dans l’acte III de la pièce, Juliette loue la nuit comme le sanctuaire de ses réunions clandestines avec Roméo, tandis que, dans le quatrième acte, le motif devient une « nuit de mort », ouvrant la réunion définitive des deux amants par-delà les interdits sociaux et les barrières spatiales qui les séparaient de leur vivant.
Ce thème romantique, enfin, est porté à son apogée par Richard Wagner, dans Tristan et Iseult (1865), avec l’« hymne à la nuit » chanté par les deux amants dans l’acte II. Ici encore, la Nuit est célébrée comme l’espace propre aux amoureux, par opposition au Jour qui correspond au règne du roi Marc et aux lois du monde social et rationnel :
Nuit auguste, nuit d’amour,
Etouffe, pour jamais, l’éclat trompeur du jour !
Etends ton ombre, éteins les flammes
Des vastes plaines de l’azur ;
Confonds nos cœurs, confonds nos âmes,
Au sein sacré du gouffre obscur10.
Dans la dernière scène, en mourant près de Tristan, Iseult chante le fameux Liebestod de l’opéra, sa « mort d’amour », célébrant l’union désormais éternelle avec son amant, par-delà le Jour incarné, dans une Nuit qui ne connaît ni fin ni séparation ontologique. « La vie, c’est en effet le jour terrestre des êtres contingents et le tourment de la matière », écrit Denis de Rougemont dans son étude sur le mythe occidental de l’Amour tel que véhiculé par la légende de Tristan et Iseult ; « mais la mort, c’est la nuit de l’illumination, l’évanouissement des formes illusoires, l’union de l’Âme et de l’Aimé, la communion avec l’Être absolu11 ».
C’est sous cet héritage de la nuit d’amour « romantique », où l’union nocturne avec l’autre figure une sorte de seuil, que se placent nos fictions oniriques, à la marge du classicisme hollywoodien et pourtant représentatives de ses inspirations profondes. Loin de se limiter à une zone spatio-temporelle ou à un cadre purement formel, la nuit y intervient au contraire comme un motif esthétique à valeur de symbole. Dans ce « lieu » qui n’est pas un lieu, l’obscurité fait le vide du Jour et ménage à sa place un espace merveilleux, obscur parce qu’au-delà des limites sensibles et caché pour la raison, où triomphe dans son intimité nocturne le couple qui s’aime.
Si telle peut en effet être génériquement définie la nuit dans ces fictions – comme un espace d’amour soustrait au sensible et à la raison, évoquant à la fois connaissance de soi et au-delà de la mort –, le geste critique permet néanmoins d’approfondir le thème, en dégageant les aspects dominants et les variantes qu’il revêt au fil des films. Sans prétendre à l’exhaustivité, tentons à tout le moins d’en définir le spectre et les formes essentielles, de la rêverie au délire psychotique, en passant par la féérie et l’amour fou.
Nuit de rêve : Peter Ibbetson
Soit pour commencer la nuit comme pays du rêve dans Peter Ibbetson. Réalisé par Henry Hathaway d’après le roman éponyme de George du Maurier, le film s’ouvre par une scène brève mais capitale à travers laquelle sont relatées les amours enfantines de Pierre et Mimsey, brutalement interrompues par la figure parasite de l’oncle maternel. Cette période idéale est scellée par une phrase prophétique de la mère de la petite fille, prononcée alors que le jeune garçon est emporté loin de Mary, et expliquant d’avance le caractère surnaturel des événements à venir : « Un amour d’enfance n’est jamais oublié ».
Dans la période adulte qui occupe le reste du récit, une étonnante communication mentale s’établit de fait entre les deux protagonistes. Alors qu’ils se rencontrent pour la première fois dans la grande propriété de Mary, tous deux miment sans le savoir la « dispute » inaugurale de leur enfance. Affublés de nouveaux noms qui, pour l’heure, les rendent l’un pour l’autre méconnaissables (Mary est devenue la duchesse de Towers, Pierre s’est anglicisé en Peter et doublé du nom maternel d’Ibbetson), les deux personnages sont rapidement frappés d’une étrange communauté entre leurs rêves. S’immisce ainsi le thème romantique d’une interaction possible entre réalité et imagination, ouverts l’un dans l’autre – pour reprendre la formule d’André Breton – tels deux « vases communicants »12.
Introduit comme une donnée poétique, le nocturne trouve un traitement formel dans l’ultime partie du film où Peter, après avoir accidentellement tué le duc de Towers, est emprisonné et réduit à l’immobilité dans sa geôle. Évanoui sur sa couche, il voit subitement lui apparaître Mary auréolée d’un rayon de lumière, qui l’invite à s’échapper avec elle vers le pays du rêve. Encore sous l’emprise de la raison, que typifie l’espace de la prison autour de lui, le héros refuse tout d’abord de franchir mentalement la grille de sa geôle, et le songe se dissipe ; mais la jeune femme lui annonce qu’à l’aube, elle lui fera parvenir l’anneau qu’elle porte au doigt en gage de la réalité du rêve. L’objet en main dans sa cellule, Peter le déclare tout un monde, et s’ouvre alors, par le truchement de cette bague symbolique qui contient effectivement toutes les richesses du rêve, la série de nuits merveilleuses au cours desquelles les deux personnages, désormais libérés des entraves du monde social et sensible, peuvent vivre un amour illimité et qui n’appartient qu’à eux, à l’instar des amants rédimés du Cottage enchanté (The Enchanted Cottage, première version en 1924 par John S. Robertson, fig. 10).


Fig. 10
Ce rêve partagé prend place dans le jardin de la grande propriété d’autrefois, où les deux personnages adultes jouent et se promènent dans leurs vêtements enfantins. Toute la poésie et la beauté de ce lieu onirique tiennent dans le fait qu’il est possible d’y retrouver le temps perdu et de le prolonger par la force de l’imagination. À l’image de ce chariot jamais achevé dans l’enfance et que Pierre construit désormais avec Mary, avant de s’élancer avec elle dans les plaines du rêve et de suivre sur le sol les empreintes de leurs mois enfantins, vestiges sensibles restés intactes dans l’enceinte de leur mémoire commune. Parvenus au sommet de plaines imaginaires, Mary fait don à Peter d’un air de musique qu’une harpe invisible joue à son commandement dans le ciel, véritable « musique des sphères » dédiée à son amoureux, tandis que ce dernier, en bon architecte, conçoit pour elle, au sommet d’une colline, un château merveilleux tout droit inspiré du rêve fou de Louis II de Bavière (fig. 11).


Fig. 11
Ces nuits oniriques, qui durent toute la vie du couple, trouvent inévitablement à la fin un pendant cauchemardesque, quand Mary, morte dans le monde physique, disparaît subitement des bras de Peter dans le rêve. Le héros désemparé erre alors seul dans l’espace enténébré du songe, plongé dans une nuit de brumes qui connote l’absence de Mary. Mais celle-ci s’adresse au héros depuis un rayon de lumière surplombant et lui annonce que, au-delà de la station intermédiaire du rêve, se trouve un pays plus beau encore, peuplé de fleurs radieuses. Mary disparue, les gants laissés par cette dernière dans le rêve attestent une fois de plus – à l’instar de l’écharpe de Jennie – la vérité de la vision, et Peter âgé peut finalement s’effondrer dans l’obscurité de sa geôle, la main tendue comme en possession des gants ramassés au sein du songe, et disparaître dans la lumière comme en cette Nuit radieuse où Mary l’attend (fig. 12).




Fig. 12
Nuit féérique : Brigadoon
Le thème du rêve se prolonge avec la féérie nocturne dans Brigadoon. Dans ce film de Vincente Minnelli, issu d’une pièce de Broadway13 elle-même inspirée des Märchen, les contes de fées allemands, le héros interprété par Gene Kelly découvre dans les Highlands d’Écosse un village merveilleux littéralement figé au milieu du XVIIIème siècle, où, fait notable, les mariages sont célébrés sous un ciel de nuit. La jeune paysanne dont il s’éprend, incarnée par Cyd Charisse, est amenée à le conduire au « maître du village », qui lui révèle immédiatement la signification symbolique du lieu (fig. 13).



Apparaissant sur Terre et vieillissant un jour seulement tous les cent ans, Brigadoon demeure préservé de l’influence du monde extérieur, dominé par l’égoïsme et la raison, et reste insensible au passage et à l’emprise du temps. Un habitant du monde contemporain, précise néanmoins le guide, pourrait intégrer le village et atteindre à l’immortalité, « à condition d’aimer l’une de ses habitantes suffisamment pour être prêt à tout sacrifier pour elle » ; à condition d’être prêt à échanger l’amour et le rêve contre la réalité tangible et rationnelle.
C’est dans le cadre de cette problématique que le motif nocturne, charnière dans le film, intervient à plusieurs reprises peu avant sa fin. Il y encadre d’abord la dernière danse du couple, alors que le héros, en proie aux hésitations, est sur le point de quitter le village merveilleux pour retourner à son monde et à la fiancée matérialiste qu’il n’aime pas. Au cours de cette danse d’adieux, l’arche en ruine qui s’élève derrière le couple en train de danser porte la trace, comme d’autres paysages du film, plus encore que des romantiques anglais cités par Minnelli, de l’œuvre de Caspar David Friedrich, en l’occurrence la toile Le Rêveur (1835-1840)14. Son protagoniste, vêtu d’un costume moderne, y contemple justement le pays du rêve depuis le seuil liminaire du monde diurne qu’il n’ose franchir, à l’instar de Gene Kelly caressant dans sa tenue moderne le rêve de Brigadoon au seuil de la réalité (fig. 14).



D’une étreinte rêveuse où les corps amoureux s’entrelacent et se mêlent chromatiquement, la nuit romantique de Brigadoon se change en une nuit d’errance et de doute quand, rappelé aux impératifs de son monde quotidien et rationnel, abandonnant Cyd Charisse et Brigadoon, Gene Kelly tourne à contrecœur le dos au village qui disparaît aussitôt dans un amas de brumes, pareil à un rêve merveilleux dissipé par l’éveil (fig. 15).



Présenté comme une « nuit » spirituelle, cet éveil à la raison est immédiatement typifié à l’écran par la ville de New York, introduite avec une vue nocturne et plongeante sur les édifices de Manhattan qui rappelle singulièrement les photographies de la métropole par Berenice Abbott, où des mêmes édifices photographiés la nuit émane une atmosphère frénétique et inquiétante, également connotée dans le film par l’entrée en scène de phrases musicales discordantes.
Le thème nocturne se prolonge alors avec la traditionnelle scène minnellienne de la party, à travers laquelle le monde urbain et contemporain est présenté comme une foisonnante parade de masques et une cacophonie insensée. Dans cette « nuit » spirituelle où Gene Kelly retrouve la fiancée qu’il n’aime pas (interprétée par Elaine Stewart), tandis que celle-ci parle inlassablement sans être écoutée de lui, la voix du personnage de Cyd Charisse continue pourtant de fredonner ses chansons en off, qui résonnent sur la bande son comme autant d’appels dans l’esprit du héros, lui rappelant la persistance du rêve en dépit de son invisibilité (fig. 16).



C’est à l’heure nocturne, enfin, que Gene Kelly s’en retourne dans les Highlands et fait intimement le vœu d’échanger son monde et sa nuit insignifiante pour le rêve et Cyd Charisse. Alors, comme en réponse à ce souhait, le village magique réapparaît à sa vue. Et tandis que le couple se rejoint finalement dans la nuit, sur la place où par-dessus les âges fut jadis interrompue leur dernière danse, les chœurs de villageois chantent que Brigadoon, ce « village » qui n’apparaît pas sur la carte – ce pays du cœur et de l’amour –, est un lieu que l’on porte à l’intérieur de soi. Manière de signifier que Brigadoon, « u-topique » au sens de Thomas More, de « non-lieu », se trouve nulle part et partout à la fois – là où la poésie triomphe du monde diurne et conformiste, où la Nuit et le rêve s’affirment sur le Jour (fig. 17).


Fig. 17
Nuit d’amour fou : Pandora
Lieu du rêve et de la féérie dans Peter Ibbetson et Brigadoon, la nuit module et devient dans Pandora un espace de communion sur le mode de l’amour fou, corrélé dans le film au thème de l’éternel retour et de la transcendance du temps. Érudit proche du mouvement surréaliste, Albert Lewin, qui conçoit la totalité du film, y mêle le mythe du « Hollandais volant » (tel que canonisé par Richard Wagner d’après la nouvelle de Henrich Heine publiée en 1835, « Les mémoires de Monsieur de Schnabeléwopski ») et le trope « gothique » du Döpelganger. Ava Gardner y incarne ainsi deux versions de la même femme, à la fois épouse du « Hollandais volant » au XVIIème siècle et chanteuse de cabaret dans les années 30, appelée à tomber amoureuse du même homme devenu fantôme. Au cœur de cette problématique amoureuse et métaphysique intervient ici encore le topos de la nuit.
Celle-ci plane d’une part tout au long de Pandora à travers l’esthétique surréaliste déployée par Lewin, avec ses bustes grecs qui jalonnent les plages espagnoles nocturnes, en une citation explicite du cycle de Giorgio de Chirico autour de la figure d’Ariane, où de tels bustes féminins trônant dans des décors méditerranéens évoquent, comme les femmes pastorales de Thomas Wilmer Dewing, un amour idéal, soustrait aux contingences terrestres. Figures d’un amour libéré des entraves physiques et temporelles, le couple lewinien marchant parmi ces décors file par là même un thème hollywoodien des années 50, qui s’exprime en particulier à travers l’Italie antique et notamment Pompéi, comme dans Les Amants de Capri (September Affair, 1950) de Dieterle et Voyage en Italie (Viaggio in Italia, 1954) de Roberto Rossellini, ou, dans une autre cinématographie, Les Amants de Vérone (1949) d’André Cayatte (fig. 18).


Fig. 18
Au milieu de tels vestiges, lors d’une scène tournée en « nuit américaine », les deux amants se déclarent leur amour et s’embrassent avec fougue en cet espace-temps transitoire, à la fois de la plage et de la nuit, où passé et présent, le mort et la vivante, le mari et la femme, corps et âmes s’unissent presque déjà par-delà les temporalités (fig. 19).


Fig. 19
Cette réunion éternelle sera rendue effective à la fin du film, avec les dernières retrouvailles nocturnes des deux amants sur le yacht du Hollandais. La nuit, associée cette fois-ci non plus à l’espace liminaire de la plage, mais à la mer elle-même, à l’au-delà du seuil, y figure cette dimension intemporelle et désincarnée, où les corps amoureux – forts de la sensualité paradoxale que leur confèrent à l’écran les couleurs vives de la photographie de Jack Cardiff aussi bien que la beauté magnétique d’Ava Gardner – s’unissent par une étreinte sensible dans la mort et l’éternité (fig. 20).

Cette dernière – l’éternité – est finalement représentée par un sablier qui se brise sur le yacht et dans la nuit, écho direct, de la part de Lewin, au sablier photographié par Man Ray avec lequel André Breton concluait L’amour fou – en lui associant ces mots : « Toujours, comme sur le sable blanc du temps et par la grâce de cet instrument qui sert à le compter mais seulement jusqu’ici vous fascine et vous affame, réduit à un filet de lait sans fin fusant d’un sein de verre15 » – pour illustrer cette même conception d’un amour surréaliste, à la fois prophétique et sensuel, auquel la nuit, dans Pandora, fournit un cadre esthétique et symbolique (fig. 21).



Nuit délirante : Vertigo
Réunion par-delà la mort et le Temps, amour prophétique et sensuel, voilà précisément le rêve que caresse Scottie dans Vertigo, où la « nuit » devient cette fois – et pour finir – le « lieu » où les rêves d’éternité flirtent avec le désordre mental et la psychose. Inspiré du roman D’Entre les morts (1954) de Boileau et Narcejac, comme de Bruges-la-morte (1892) de Georges Rodenbach16, le film reprend aussi le mythe d’Orphée descendant aux Enfers pour ressusciter Eurydice, puis la perdant lorsqu’il tente de s’assurer de sa présence par un regard.
C’est dans la nuit, au restaurant d’« Ernie », que tout commence, puisque Scottie y aperçoit pour la première fois la silhouette de Madeleine. Partant du héros qui l’épie depuis le comptoir, la caméra effectue une circonvolution jusqu’à découvrir le corps de la jeune femme assise dans le réfectoire, comme pour connoter déjà le désir vertigineux qu’elle suscite dans le cœur troublé de Scottie. Le thème merveilleux de Bernard Hermann s’enclenche au moment précis où Madeleine apparaît dans le champ, entourée du décor cramoisi du restaurant, couleur du désir, tandis que le châle de soie vert qu’elle porte aux épaules lui confère déjà, dans cette première scène, une aura spectrale et fantomatique (fig. 22).


Fig. 22
Si Hitchcock n’exploite pas encore ici le motif nocturne en tant que tel, sa présence connote d’emblée le thème du rêve et du fantasme, auquel demeure inextricablement associée la jeune femme dans le film. La « nuit » trouve en revanche un puissant enrichissement formel dans la célèbre scène où Judy, déguisée par Scottie, ressuscite soudain en Madeleine dans la chambre d’hôtel, comme Eurydice revient à la vie devant les yeux d’Orphée au fond des Enfers. Se noue dans cette scène et autour de sa symbolique nocturne toute la problématique complexe du film où Scottie, berné par le subterfuge, s’imagine retrouver la défunte Madeleine en embrassant Judy, laquelle n’est autre que celle qui, complice du crime, conféra jadis un corps à Madeleine, le fantôme, celle qui n’a jamais existé.
Alors que Judy/Madeleine apparaît dans l’obscurité au sortir de la salle de bain, la lumière verte de l’enseigne de l’Empire Hotel, qui éclairait jusqu’ici la chambre, se meut en un halo de lumière surnaturelle, obtenu par un filtre appliqué sur l’objectif, pour corroborer, dans les termes de la symbolique américaine – celle de Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby, 1925) ou de La Lumière verte (Green Light, 1935) par exemple – la résurgence de l’autre monde. La musique de Bernard Hermann, explicitement inspirée du Prélude de Tristan et Iseult, accompagne le baiser des deux amants, du psychotique et de la morte, tandis que le célèbre travelling réalisé en cercle autour du couple évoque l’entrelacs complexe du rêve et du mensonge, aussi bien que l’anneau de mariage et sa symbolique de l’éternité.
La « chambre noire » de Vertigo devient alors le lieu de la projection intradiégétique de Scottie, comme de celle – extradiégétique – d’Alfred Hitchcock lui-même, quand la caméra tournant autour du couple révèle, par un subterfuge de mise en scène – une transparence –, le décor de la Mission Dolorès où avait pris place l’ultime baiser entre Scottie et Madeleine, juste avant la disparition de cette dernière. Enfin, passée cette projection intra et extradiégétique, la lumière verte diffusée par l’enseigne de l’hôtel envahit inexplicablement l’espace de la chambre, évoquant, de la manière la plus exemplaire, le fantastique de cette nuit d’amour, espace mental teinté de vert – la couleur de Madeleine, du fantôme –, où le souvenir et l’expérience vécue s’entremêlent, à la façon proustienne, pour rédimer le Temps (fig. 23).


Fig. 23
Anneau de Möbius inséré dans un récit de crime et de manipulation, la « nuit » reste dans Vertigo d’une profonde ambiguïté : interne à l’esprit de Scottie, lui-même pris au sein d’un subterfuge, la transcendance et le rêve qu’elle évoque ne s’y font jour que sur un fond de mensonge et d’absence – cette vacance envahissante que représentent dans le film le corps et l’aura fantomatique de Madeleine. Les nuits « objectives » de Peter Ibbetson et de Brigadoon, de L’Aventure de Mme Muir et de Pandora, se dégradent ici en une version subjective où, comme dans Aurélia de Nerval, le merveilleux ne semble avoir de réalité que dans l’esprit d’un fou.
Que Scottie s’éveille au Jour et à la raison, aussitôt le rêve laisse voir dans sa brèche l’insupportable vacuité du réel. Lorsqu’il comprend le subterfuge en apercevant au cou de la vivante le collier de la morte, et que Scottie entraîne Judy – qu’il sait désormais être le double de Madeleine – au sommet du clocher, la jeune femme, en lui révélant son sincère amour, chute du haut de l’édifice pour allier son sort à la morte. Pareil à Orphée, Scottie perd alors la nuit et le rêve pour avoir voulu y faire pénétrer la certitude de la raison ; et ne peut que ressurgir, fantomatique, dans ce vert mental des nuits de jadis fantasmées par Scottie, l’image vacillante de Madeleine imaginée au seuil de l’orgasme, sur le point déjà de s’évanouir et de s’arracher du cadre au cœur même de l’étreinte (fig. 24).

Fig. 24
Ainsi Vertigo achève-t-il le tableau de nos nuits d’amour, en composant pour le thème un pendant subjectif et morbide ; où le jour, remplaçant la nuit illusoire et néanmoins réelle, laisse émerger dans son propre vide la réminiscence d’un songe à la fois délicieux et amer.
Guilain Chaussard
- Jean-Loup Bourget, Hollywood, la norme et la marge : genres, esthétiques et influences du cinéma hollywoodien (1930-1960), Paris, Armand Colin, 2005, 2ème édition, 2016. ↩︎
- La musique du Portrait de Jennie est arrangée par Dimitri Tiomkin, avec la participation de Bernard Hermann pour la « comptine » de Jennie. ↩︎
- Dans une fine analyse du film, Fabien Delmas propose un rapprochement avec le romantisme allemand, justifié notamment par la collaboration de Dieterle avec Max Reinhardt sur Le Songe d’une nuit d’été (A Midsummer Night’s Dream,1935) (« De l’onirisme à Hollywood : les songes de William Dieterle », Ligeia n° 129-132, 2014/1, p. 103-104). Le contexte américain du Portrait de Jennie ainsi que les références répétées à la tradition nocturne invitent plus encore le rapprochement avec des œuvres états-uniennes, ce qu’il est possible de corréler à la personne de Selznick. ↩︎
- Hélène Valance, Nuits américaines : l’art du nocturne aux États-Unis, 1890-1917, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2015, p. 111. ↩︎
- Marchant seul dans les jardins nocturnes et enneigés avec ses toiles sous le bras, en méditant sur l’altération de ses sens due au manque de nourriture, Eben Adams pourrait faire songer à Van Gogh et à ses visions nocturnes impressionnistes peintes sous l’emprise de l’absinthe. ↩︎
- Celui-ci, peint dans un style réaliste proche du premier tableau du Portrait de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray, Albert Lewin, 1945), est l’œuvre de Robert Brackman. ↩︎
- Différence importante d’avec le roman originel de Robert Nathan, sur laquelle Selznick insiste dans un mémo adressé à l’écrivain (voir Memo From David O. Selznick, Hollywood: Samuel French, 1989, p. 374). ↩︎
- Cette fin du Portrait de Jennie peut, au même titre que l’ensemble du film, être comprise comme un hommage rendu par Selznick à l’actrice Jennifer Jones (de son vrai nom Phylis Lee Isley), ainsi nommée par ce dernier et alors épouse du producteur. ↩︎
- À noter que William Dieterle est l’assistant de F. W. Murnau sur Faust, une légende allemande (1926), dont la célèbre scène d’envol s’inspire esthétiquement de la même toile. ↩︎
- Richard Wagner, Tristan et Iseult. Poème et musique, trad. fr. Victor Wilder, Breitkopf & Härtel, 1886, p. 46. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5467721c.texteImage. ↩︎
- Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, Paris, Plon, 1972, p. 116. ↩︎
- André Breton, Les Vases communicants (1932). Dans L’Amour fou, l’auteur proclame le film de Hathaway « triomphe de la pensée surréaliste » (Gallimard, 1937, p. 113, note 1). ↩︎
- Brigadoon, comédie musicale en deux actes écrite par Jay Lerner et composée par Frederick Loewe en 1947. ↩︎
- Le paysage des landes où, plus tôt dans le film, les deux personnages effectuent leur première danse s’inspire jusqu’au moindre détail de la toile L’Été (1807) du même peintre, à l’exception du ciel nuageux destiné à s’accorder avec les paroles originales de Loewe et avec le caractère indécis du rêve. ↩︎
- André Breton, L’Amour fou, Paris, Gallimard, 1937, p. 171. ↩︎
- Voir l’article d’Ana González Salvador, « De la ressemblance : Georges Rodenbach/Alfred Hitchcock », dans Le Monde de Rodenbach, études et documents réunis par Jean-Pierre Bertrand, Bruxelles, Labor, 1999, p. 105-118. ↩︎
