Irréfragable, un noyau de nuit hante ce cinéma. Une nuit, ici entendue non plus tant comme la phase qui succède au jour, que comme son verso ou son autre ; la nuit comprise maintenant comme l’inquiétude du jour, la nuit, et plus exactement le nocturne, comme un climat. Le nocturne, c’est ce qui mine – parfois secrètement, parfois avec fracas – le régime diurne, clair et distinct de l’intérieur. Le jour se voit ébranlé, taraudé par la hantise de son propre effondrement.
Tout le travail de l’artiste thaïlandais Apichatpong Weerasethakul accorde une place essentielle précisément à cette notion de nocturne qu’on tente ici de déterminer. Sans doute d’abord puisque le sommeil et le rêve sont des motifs récurrents de ses films. Mais avant tout parce que quelque chose comme une climatique de l’étrange fait planer sur ces films une opacité fondamentale, qu’elle soit plastique, esthétique (l’hésitation formelle entre divulgation et occultation, exprimée par la photographie mais aussi le cadre et le montage) ou narrative (opacité des significations et des acceptions, exprimée aussi par la figure du presqu’être qu’est le fantôme, de la subtilité et de la labilité de son corps).
Une nuit travaille ces films, l’autre du jour, une nuit sans antonyme, intransitive, anarchique et totale (autarcique), et que pourrait bien désigner, à condition d’en entendre la puissance, le mot nocturne. Ce cinéma est dominé, dans sa puissance opaque et mythique, par un lieu crucial : la jungle. À la lisière entre l’ouverture solaire de la clairière et la densité, la fermeture obscure de son cœur, et qu’elle soit inquiète (Blue) paisible (Oncle Boonmee) ou sauvage (Tropical Malady), ces jungles sont la réserve d’une énergie secrète et nocturne. On reconnait une très vieille connivence, comme une coalition, entre la nuit et la forêt, dans les contes, l’imaginaire littéraire, mythique, fantastique.
Je voudrais montrer que ces jungles sont intrinsèquement nocturnes et intérieures. Il faudrait, pour bien les appréhender, leur apposer, selon la convention scénaristique, et systématiquement les indications « intérieur/nuit ». Parfois, souvent, scindés en deux parties, les films de Weerasethakul virent comme en leur propre envers nocturne, délivrés des topographies et temporalités narratives traditionnelles, ou muent comme le dit Antony Fiant1.
Je montrerais premièrement sous un intitulé Nuit blanche, comment et combien le nocturne chez Weerasethakul est extatique, que la jungle est nécessairement une nuit, et comment cette nuit est une présence d’absences. Ensuite, et en observant la nuit intérieure qu’est le film Oncle Boonmee, je voudrais aborder l’espace de la grotte comme nuit intérieure, aussi comme nuit des temps. Dans mon troisième temps, il fera nuit noire, cette fois, où j’aborderai l’idée d’une nuit emplie, réserve de toute visibilité, noir complet d’où surgissent des évènements-avènements d’images. Dans toutes ces nuits enfin, et sans cesse, des notes comme on dirait de musique, mais ici de lumières, apparaissent, avec le triptyque préféré du réalisateur : néon, lune, luciole ; Cette dernière belle figure de la luciole sera comme mon guide.
1. Nuit Blanche
L’extase des choses
Tout commence par une nuit blanche : ce monde de la jungle la nuit, envers du monde social, clair et distinct, envers de la ville à midi, est un monde poreux, dissolu (aux deux sens du terme, le sens physique chimique de confus, d’indistinct, et au sens moral de déréglé) et où, dans le cinéma de Weerasethakul en particulier, humains, plantes, animaux, fantômes se rencontrent, apparaissent et disparaissent, s’embrouillent.
Il y a dans cet espace, ce milieu qu’est la nuit, dissolution des repères spatio-temporel, pour que s’ouvre un espace extatique. En ce sens, la nuit d’Apichatpong Weerasethakul est bien, si on emprunte la distinction faite par Judith Langendorff une figure-forme et non une figure-image2 (image de la nuit, forme qu’est la nuit) donc une nuit symbolique, une forme relevant de la Stimmung qui émane, entre-prend les choses et les êtres. Cette entre-prise convoque l’idée d’extase des choses de Gernot Böhme3, une contamination des choses à leur entour, comme on va le voir.
Le court métrage Blue, réalisé pour l’Opéra de Paris, est filmé durant 12 nuits dans la jungle thaïlandaise. Une femme essaye de dormir. Par transparence et surimpression, une petite flamme d’abord, puis un feu de plus en plus conséquent semble ronger la couverture et le cœur de la femme insomniaque. S’il on voulait transposer les dénominations des formes musicales au cinéma, on pourrait appeler Blue une Barcarolle, cette musique avec un rythme rappelant celui de la barque. Le mouvement pendulaire et de balancier des panneaux de toiles qui, tout au long du court métrage, descendent et remontent sur leur châssis mécanique, crée une cadence de berceuse. Concurremment, la nappe sonore des grésillements des insectes, des bruissements de la végétation, berce ou entête la scène. Ce serait alors une barcarolle, non tant reposante que paradoxalement fiévreuse, rongée par la progression, la propagation irrépressible du feu.



Blue
Voici le jeu d’un diptyque : le feu rouge orangé, chaud, en surimpression ou reflet sur la couverture bleue, teinte froide. Ce bleu et cet orange, couleurs complémentaires4, fabriquent une image oxymorique, entre paix, silence d’un côté, et cri, tourment de l’autre. Une nuit bleue, comme le titre l’indique, mais un bleu envahi par une morsure, ou comme blessé d’une petite plaie. C’est cette première étincelle, le petit rond, la petite tache orange sur le cœur de la dormeuse, que je considère comme ma première petite luciole, insecte grandissant, et qui va submerger – extase des choses qui contaminent – va envahir la nuit habitée par ces flammèches hypnotiques.
La jungle est une nuit
Or tout le cinéma de Weerasethakul, et crucialement la jungle, considérée comme espace hypnotique, est bien nocturne, d’abord selon cette dichotomie qui classe le diurne, le soleil, comme emblème de la raison, et le nocturne celui de l’inconscient, des mythes, des rêves.
Même de jour, la jungle de Weerasethakul est nocturne, en ce qu’elle est l’occasion d’un retrait du logos. Ici et maintenant dans la jungle, le langage articulé en effet se retire, et laisse place à la langue du monde, les formes laissent place aux forces, et c’est désormais l’écoute qui prime sur la vue, ou même la vision sur la vue. Car on est davantage visionnaires que voyants, et les choses se révèlent plus qu’elles ne se montrent comme à l’ordinaire. La jungle, quand elle est filmée de jour, serait peut-être alors, un nocturne blanc. Je pense à Jankélévitch, qui, dans La musique et les heures, mentionne un nocturne blanc et un nocturne noir qui se rejoignent : ils ne parlent tous deux qu’à l’insomniaque, aux « âmes vigilantes ». Il rapproche la nuit et l’aube, le matin, comme si la « nuit béatifique » et « le premier matin du monde », n’étaient « qu’une seule et même nuit5 ».
La présence d’absence
Nuit blanche, nocturne blanc, l’insomnie, filmée dans Blue, me rappelle aussi l’expérience de ce que Emmanuel Levinas appelle l’il y a. – (L’il y a est décrit notamment dans le chapitre « Existence sans existant », de De l’existence à l’existant.) Il y a, dit Levinas, c’est l’engloutissement dans le pur fait d’être. L’il y a signe une présence irrémissible, rivant l’être-là dans l’inamovibilité. C’est ça, l’insomnie, la nuit qui vous rive à l’irrémissible de la présence.
Voici ce que dit Levinas :
« Lorsque les formes des choses sont dissoutes dans la nuit, l’obscurité de la nuit, […] envahit comme une présence. Dans la nuit où nous sommes rivés à elle, nous n’avons affaire à rien. Mais ce rien n’est pas celui d’un pur néant. Il n’y a plus ceci, ni cela ; il n’y a pas “quelque chose”. Mais cette universelle absence est, à son tour, une présence, une présence absolument inévitable6 ».
Il faudrait alors dire non plus : nous n’avons affaire à rien dans la nuit, mais nous avons affaire à rien, où rien est déjà quelque chose. Dans la jungle, dans sa nuit, il y a rien. Ce il y a acte une disparition des choses, et en même temps consigne une présence irréductible aux apparitions matérielles. La nuit cheville le corps à son « être-là ». Elle fait apparaître le fait qu’il y a de l’inapparent. Dans un paradoxe, le néant, le vide que la nuit révèle, se découvre une positivité, et s’expose dans le noir en une pleine présence.
2. Nuit intérieure
Grotte, Intérieur/Nuit
Un autre espace est primordial chez Weerasethakul : c’est la grotte. Un espace intrinsèquement nocturne. Comme la jungle, comme la nuit, la grotte est un espace informe, vivant, originel.
Un des lieux essentiels du film Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, le long-métrage qui a consacré Weerasethakul, est une grotte. À l’heure de mourir, l’oncle Boonmee, accompagné de ses proches, s’engouffre dans les tréfonds de la jungle – et se réfugie à l’intérieur d’une grotte mystérieuse. Ils s’enfoncent dans les cavités, à tâtons, comme quittant le monde familier, sa clarté, son intelligibilité, pour descendre dans ce lieu outre ou centre intime. Ils finissent par découvrir une salle fantastique aux parois scintillantes, que leurs lampes de poche font étinceler. Un instant, cette nuit étoilée irradie, puis le noir total envahit l’écran.


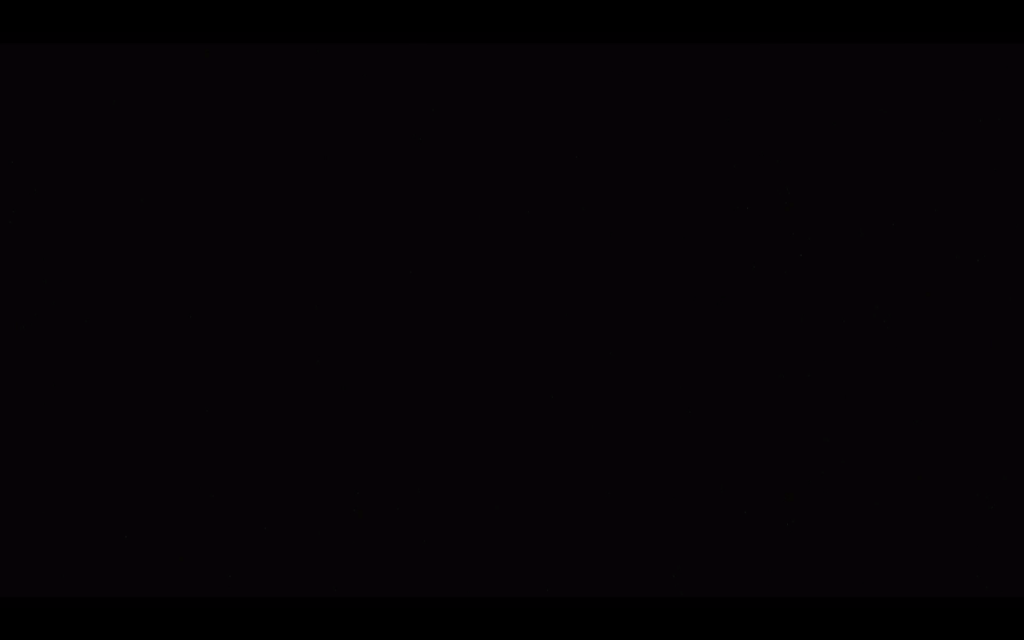
Oncle Boonmee
… Jusqu’à la nuit noire. Au son, on est bien dans un intérieur, comme sous l’eau, ou comme si on s’était collé un gros coquillage sur l’oreille, le son proche de ce battement de pouls, caverneux. Intérieur et extérieur deviennent réversibles, avec l’obscurité qui les ceint, comme si le monde n’était plus devant les protagonistes, mais autour d’eux et en eux, ou eux en lui. L’espace est celui que décrit la phénoménologie où l’homme est engagé, immergé, et où il y a, dirait-on, plutôt qu’un anthropomorphisme des choses, un cosmomorphisme des êtres. C’est la nuit du cosmos, voici que l’espace est galactique, scintillant d’étoiles. En appelant de nouveau ma figure de la luciole, c’est cette fois non plus une petite lueur comme au départ du feu de Blue, mais des myriades de lucioles miroitantes.
Ce cosmos est étrangement un intérieur : c’est un intérieur non seulement plastiquement, puisqu’à l’image la grotte (autre jungle) est pleine, ronde, sans espace, sans air, close, comme la jungle est filmée le plus souvent sans trouées, mais c’est aussi un lieu intérieur fondamentalement, en tant que for intérieur. Un lieu For dirait Derrida7, dans lequel on retrouve ses fantômes. Un intérieur pas tant psychologique des personnages, mais où se joue une intimité plus charnelle, plus universelle.
La nuit des temps
Animée par le passage de la lampe de poche, la matière, la roche apparaît vivante, organique, expressive. On suppose que les hommes préhistoriques faisaient en quelques sorte leur premier cinéma en animant les peintures rupestres avec leur torches8, ici en une reprise de ces gestes ancestraux, les anfractuosités et les sculptures des murs remuent, dansent, propices à toute paréidolie9. Dans la nuit, se joue une physique essentiellement inchoative. L’obscurité nocturne tire ici aussi sa puissance évocatrice de son aptitude à créer un gigantesque espace de projection. On pense à cette nuit de la salle de cinéma, autre expérience intimement nocturne, lieu de puissance génératrice. Utérin. L’oncle Boonmee, le personnage qui va mourir bientôt d’ailleurs le formule très explicitement « Cette grotte est comme un utérus n’est-ce pas ? Je suis né ici, dans une vie dont je ne peux me rappeler. Je sais seulement que je suis né ici. Je ne sais si j’étais un être humain ou un animal, un homme ou une femme. » On a remarqué que l’entrée de la grotte, ressemblait d’ailleurs étrangement à un entrejambe. « Je suis né ici, dans une vie dont je ne peux me rappeler », où il s’agit au fond d’une origine non pas individuelle, personnelle, mais relevant d’une antériorité sans doute plus radicale. Plutôt qu’anti-narratif, un ante-narratif. En effet, on quitte en ces lieux la narration diurne, l’espace clair euclidien, pour un envers sensible, nocturne de la narration. C’est alors que la nuit devient, une fois de plus, moins ce qui succède au jour et le précède, que cet « autre » du temps. Une nuit des temps. Erik Bordeleau parle dans les mêmes termes :
« L’œuvre d’Apichatpong n’a ni début ni fin chronologique. Il n’y a de début que dans le sens d’émergence cosmique ou d’éternel retour que nous donnons à ce terme (en suivant Nietzsche et Guattari)10 ».
Je pense maintenant aux ténèbres. Théologiquement, les ténèbres sont le temps immémorial qui précède la création du monde. Elles règnent donc avant même l’apparition de l’alternance entre le jour et la nuit. Cette nuit d’avant les nuits est alors consubstantielle, sans plus aucun jour à quoi elle pourrait se référer, elle est pleine. Au cinéma, c’est aussi une présence sensible, une substance qui peut être dense, presque tactile, haptique. C’est de cette nuit pleine, texturisée que je voudrais maintenant parler.
3. Nuit noire
La pleine nuit
Descendus avec le vieil oncle au cœur de la grotte, la nuit noire nous a absorbé dans son étreinte. Dans cette nuit profonde, un autre genre de rapport au monde est advenu, un rapport phénoménologique. Merleau-Ponty11 parle d’une « spatialité sans choses », dans la nuit, qui entrave la vue sans doute, mais déploie les autres sens. Pour son film Tropical Malady, film en deux parties ou la seconde, qui est quasiment un deuxième film, est comme l’envers, le versant, la version nocturne de la première12, Weerasethakul voulait aller jusqu’à la limite du visible : sous-exposer au maximum, plonger son film dans de longues plages de noir complet13.
Antoine Gaudin dans L’espace cinématographique, étudiant les factures filmiques de la profondeur de la nuit, remarque la possibilité qu’a le cinéma de rendre une densité de texture à l’obscurité et à la nuit, un noir-matière à la grande consistance sensorielle. Un milieu, comme il est dit en biologie. On parlait d’espace utérin, voici maintenant une nuit amniotique. Pour rendre cette profondeur, cette densité, Antoine Gaudin affirme :
« Il faut, pour cela, s’émanciper d’un état normé de la nuit cinématographique (en tant que « perception moyenne » renvoyant à la « nocturnité » apprivoisée propre à l’époque moderne). Ainsi, en dialoguant avec l’attraction panique-primitive de la nuit réinvestie par le cinéma d’épouvante, il est possible d’explorer un rapport primordial à l’obscurité14 ».
Rapport primordial et primitif à l’obscurité, d’avant tout, rapport qui se noue avant toute thématisation et toute hypostase même, rapport dans le cinéma de Weerasethakul toujours éminemment physique et sensible.
La réinvention du visible
Ces nuits, blanches ou noires, de la jungle, sont une puissance réserve de visible, lieu des révélations, dont tout pourrait surgir en droit, attendant d’être actualisé, de s’exposer. Comme chez Leibniz, le fond sombre de la monade (une autre sorte de nuit) contenait en puissance le monde entier, un monde non déclaré mais présent en tant que latent, toujours dans l’atermoiement de sa prochaine advenue ou visibilisation. La monadologie15 de Leibniz présentait en effet les monades – pour le dire vite : les consciences – comme des sortes d’antres ou de réserves, contenant toute l’entièreté du monde, mais chacune n’éclairant que sa propre et unique portion, ou sa « région de monde ». De ces nuits pleines que les monades « couvent », tout pourrait donc surgir, tout pourrait avoir lieu, tout est comme tapis dans l’ombre mais pourrait bien bondir.
On peut penser des lors une telle nuit comme une « disposition d’esprit ». Un noir d’où tout vient. De cette réserve d’images, dans les films d’Apichatpong Weerasethakul, de cette nuit, des apparitions « miraculeuses » disruptives ou délicates surgissent en effet. En lutte contre la nuit, par exemple, dans Tropical Malady, un soldat – perdu dans la jungle – se trace un chemin en éclairant le sol. Voici qu’il pointe sa torche vers les arbres et reformule les choses qui étaient étouffées par la masse, la luxuriance de la jungle (leibnizienne, qui impliquait, contenait tout).
C’est donc bien ici au cœur de la nuit, au fond du noir que se conçoit une nativité des plus foncières, paradoxale nativité, puisqu’elle est apparition du non-être, visibilité de l’invisible.



Tropical Malady
Engoncé dans la nuit noire, le soldat indistinct d’avec la nuit, peut dé-couvrir des formes prodigieuses : ce corps lactescent, qui se lève du buffle mort, plus tard, cet arbre coruscant aux lucioles. Entre le buffle qui respirait et le buffle qui est mort, il aura fallu un fondu au noir et un flou, et surtout la parenthèse enchantée de l’arbre. Dans l’espace de l’arbre, et comme si la vision de l’arbre avait acté en quelque sorte le passage mystérieux, incessible, de la vie à la mort, dans l’espace de cette image, le buffle ne respire plus. La nuit génère, enfante pratiquement de telles images extatiques, dans l’intimité intérieure de ce milieu, des épiphanies arrivent, des invisibles ont lieu d’être.
Les lucioles
La figure miraculeuse qui paraît, qui transparait dans la nuit, c’est encore celle de la luciole, ici littéralement l’insecte luciole, cette figure émouvante. Je rappelle que c’est Pasolini, qui, en 1975, et dans ses écrits corsaires16, parle de la disparition des lucioles, pour dénoncer le phénomène de dégradation de l’environnement et le capitalisme en Italie, texte dont Didi-Huberman se souviendra en nommant un de ses essais La survivance des lucioles.
La figure de la luciole est donc une image de résistance, non pas éblouissante, mais luminescente, épanouie dans la noirceur.
Car c’est dans la nuit, propice aux comportements non-conformistes puisque la noirceur permet l’anonymat, que se trament les marginalités, les actions clandestines. La nuit est alors vue et vécue comme lieu d’accueil, voire de gestation de velléités, de gestes indociles, ou simplement libres. Velléités que tout récemment encore les couvre-feux ont peut-être étouffé.
Voici les mots de Didi-Huberman :
« Les fantômes, tout comme les lucioles, n’apparaissent pas au grand jour, ils attendent la nuit tombée pour se faire voir. Ils ne sont visibles que par celles et ceux qui osent sortir à cette heure, contre les indications du pouvoir dominant qui éclaire d’un « féroce projecteur » la nuit indocile17 ».
Pour le thaïlandais qu’est Weerasethakul, les fantômes renvoient surtout aux communistes persécutés par la junte militaire et poussés dans la jungle pendant les années soixante-dix, répression majoritairement censurée aujourd’hui encore.
Les images de Weerasethakul rendent à ces oubliés, même indirectement, une force d’énonciation. L’allusion en forme de sous-entendu à ces figures revenantes font de son cinéma une hantologie, et la jungle, intérieure / nuit, la nuit qu’est la jungle, comme réserve de visible, par la hantise assure la survivance de telles figures.
Il faut encore insister en concluant, sur ce que le nocturne n’est pas synonyme de nuit. Percevoir d’abord qu’il y a des nuits, de la nuit dans le jour. De la nuit dans le jour ou plutôt, je dirais des débris de nuit, en pensant à Gaston Bachelard, qui dans L’eau et les rêves pense la nuit comme une matière nocturne, dont par exemple l’étang garde en plein jour, « un peu de ces ténèbres substantielles18 ».
Il y a du nocturne, de ces débris de nuit dans tous les films d’Apichatpong Weerasethakul, y compris dans son lumineux Blyssfully Yours, version solaire et voluptueuse de Tropical Malady. Un film plein de débris de nuit, dans l’eau par exemple et pour suivre Bachelard, Weerasethakul filme un lac dans lequel se baignent les personnages aux liens ambigus. Une petite chute d’eau, un paysage édénique, mais sourdement troublé, nocturne en ce qu’un sentiment vague de désarroi et de solitude persiste, comme empoisonnant cette eau, des images qui en appellent à des forces hétérodoxes, en deçà de l’intrigue, des obscurités.
Où il s’agit encore de rendre aux images, même diurnes, leur « irréfragable noyau de nuit19 ». Un cinéma nocturne, noctambule, donc, en son principe, l’artiste intitule d’ailleurs Periphery of the Night20 son travail à l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne, et c’est bien effectivement à la périphérie de la nuit que se situe l’art de Weerasethakul ; à sa périphérie, c’est-à-dire alentour, dans ce no man’s land entre rêve et veille, réalité et imaginaire.
Les films noctambules21 d’Apichatpong se reconnaissent à leur caractère à la fois initiatique et fondamentalement a-dramatique – à leur manière, dit Erik Bordeleau dans les Fabulations Nocturnes : « de se contenter de faire doucement tomber la nuit dans le jour, pour ainsi activer le seuil minimal, liminal et éventuellement magique, du cinéma22 ».
Marianne Pistone
- Antony Fiant, « Apichatpong Weerasethakul : des films qui muent », Trafic n°53, 2005. ↩︎
- Judith Langendorff, Le nocturne et l’émergence de la couleur. Cinéma et photographie, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, « Aesthetica », 2021. ↩︎
- Gernot Böhme, L’atmosphère, fondement d’une nouvelle esthétique ? Paris, Seuil/ Communication 2018 (n°102). ↩︎
- Teintes diamétralement opposées sur le cercle chromatique. ↩︎
- Vladimir Jankélévitch, La musique et les heures, Paris, Seuil, 1988, p. 72. ↩︎
- Emmanuel Levinas, De l’existence à l’existant, Paris, Vrin, « Bibliothèque des textes philosophiques », 2013, p. 82. ↩︎
- Jacques Derrida, « Fors – Les mots anglés de Nicolas Abraham et Maria Torok », préface de 1976 au texte de Nicolas Abraham et Maria Torok, Cryptonymie, Le Verbier de l’Homme aux loups. ↩︎
- Voir Marc Azéma, La préhistoire du cinéma, Origines paléolithiques de la narration graphique et du cinématographe…, Paris, Errance, 2011. ↩︎
- La paréidolie est une forme d’illusion optique, qui fait qu’un individu identifie, dans une perception visuelle (parfois sonore), abstraite ou confuse (souvent des nuages, des roches, des surfaces murales ou naturelles texturées) une forme familière, généralement humaine ou animale. ↩︎
- Erik Bordeleau, Toni Pape, … Fabulations nocturnes, écologie, vitalité et opacité dans le cinéma d’Apichatpong Weerasethakul, Londre, Open humanities press, « Immédiations », 2017, p. 19. ↩︎
- Voici ses mots dans sa Phénoménologie de la perception : « Quand, par exemple, le monde des objets clairs et articulés se trouve aboli, notre être perceptif amputé de son monde dessine une spatialité sans choses. C’est ce qui arrive dans la nuit. Elle n’est pas un objet devant moi, elle m’enveloppe, elle pénètre par tous mes sens, elle suffoque mes souvenirs, elle efface presque mon identité personnelle. » dans Maurice Merleau-Ponty , Phénoménologie de la perception, Paris, NRF Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1964, p. 328. ↩︎
- À propos du plan noir qui scinde Tropical Malady en deux parties, Apichatpong Weerasethakul dit qu’il : « génère deux frères siamois non identiques ». James Quandt, Apichatpong Weerasethakul, Filmmuseum Synema Publikationen, Wien, 2009, p. 64. C’est aussi l’idée de « jumeaux maléfiques ». ↩︎
- Dès lors sujets et objets sont subsumés par cette nuit, tout est mouvement anonyme, chez Apichatpong Weerasethakul, les personnages se « neutralisent », dans Tropical Malady, Keng, Tong, le chaman, le tigre ne sont plus discernables, et le tigre et l’homme ne feront plus qu’un à la fin du film. ↩︎
- Antoine Gaudin, L’espace cinématographique. Esthétique et dramaturgie, Paris, Armand Colin, 2015, p. 114-115. ↩︎
- Voir Leibniz, Principes de la Nature et de la Grâce. Monadologie et autres textes 1703-1716, Paris, Garnier-Flammarion, 1996. ↩︎
- Pier Paolo Pasolini, Écrits corsaires, Paris, Flammarion, 1976, p. 184. ↩︎
- Georges Didi-Huberman, Survivance des lucioles, Paris, Les Éditions de Minuit, « Paradoxe », 2009, p. 25-26. ↩︎
- Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, Paris, José Corti, 1942, p. 118. ↩︎
- André Breton, « Entretiens (1913-1952) », in Oeuvres complètes, t. III, Paris, Gallimard, 1999, p. 519. ↩︎
- Periphery of the Night, exposition à l’Institut d’art contemporain (IAC) de Villeurbanne
,du 2 juillet au 28 novembre 2021. Un projet immersif dans lequel tous les espaces sont occupés par des entre-mondes où cohabitent humains et animaux, vivants et morts, fantômes et forêts. le projet réunit un ensemble de courts-métrages, images filmiques qui, à la manière des souvenirs, combinent différentes temporalités. Affranchie des règles qui régissent la vie diurne, la nuit se charge d’une énergie onirique et métaphorique qui modifie notre rapport au monde, notre façon de coexister. Dans ces chambres noires qui sont autant d’espaces initiatiques, une vingtaine d’œuvres, semblables aux morceaux d’une mémoire à la fois personnelle, sociale, politique, ressurgit avec la nuit. Le clair-obscur et le rythme lancinant des films invitent le visiteur à circuler d’une salle à l’autre dans un état de semi conscience, entre la veille et l’endormissement. La question est What comes with the night ? C’est précisément cet endroit, cette « périphérie nocturne » qu’explore Weerasethakul. ↩︎ - Noctambules aussi dans leur ante-narrativité, leur manière de déambuler, de muter, d’errer, de faire ligne d’erre (j’emprunte la terminologie de Fernand Deligny, qui voit, dans les déplacements des enfants autistes dont il s’occupe, des lignes errantes, ce qu’il appelle donc des lignes d’erre, opposés aux trajets utilitaires des adultes). ↩︎
- Erik Bordeleau, Fabulations nocturnes, op. cit., p. 77. ↩︎
